Ce vendredi 26 janvier 2018 est un jour quelque peu particulier à la Faculté de Médecine pour les étudiants en formation orthophonie et audioprothèse.
Effectivement, le Professeur Cécile Parietti-Winkler, responsable du Master d’Orthophonie et Directrice du Département Universitaire d’Orthophonie de l’Université de Lorraine, teste pour la première fois avec son collègue avec qui elle codirige le centre de formation en audioprothèse, le Professeur Joël Ducourneau, une innovation pédagogique ludique et active : un serious game inspiré d’un célèbre jeu de plateau, le « Time’s Up », détourné pour l’enseignement de la discipline audiologique !
Quatre-vingt-cinq étudiants, des deux formations, sont exceptionnellement réunis afin de tester leurs connaissances en audiologie, domaine qui leur est commun.
Pourquoi cette idée ?
L’enseignante nous explique :
« Ce jeu a en fait deux objectifs. Le premier est de mettre en interface des étudiants qui ne se connaissent pas mais qui sont amenés à être des professionnels de santé de disciplines très connexes (bien que différentes) car intervenant tous dans le domaine de l’audition, promouvant ainsi l’échange, la communication et le développement d’un réseau de soin. Nous souhaitons que les étudiants se rencontrent dans un environnement assez ludique.
Le second objectif est de permettre aux étudiants de ces deux centres de formation de mobiliser et restituer des connaissances socles qui leur ont étés transmises lors des cours magistraux dans la discipline audiologique. Cela leur permet de s’autoévaluer en se repérant dans leurs apprentissages et de consolider leurs acquisitions à travers cette séance de révision ludique et grandeur nature ».
Par le fait, ce jeu est vraiment perçu comme une séance de révision en vue de se repérer dans ses acquis d’apprentissage.
 Ainsi, par équipe, le but du jeu est de faire deviner un maximum de mots écrits sur des cartes.
Ainsi, par équipe, le but du jeu est de faire deviner un maximum de mots écrits sur des cartes.
Les mots ont été sélectionnés dans l’ensemble du programme d’audiologie des différents curriculi de formation concernés, et correspondent à des connaissances socles requises et communes.
Les joueurs d’une même équipe sont issus d’un mixte des différentes formations, (audioprothésiste 1ère année, audioprothésiste 3ème année, orthophoniste 2ème année).
La répartition des élèves doit être équitable pour l’ensemble des équipes. Étant donné le nombre conséquent d’étudiants, ceux-ci sont répartis dans deux salles.
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que le jeu s’est ainsi déroulé.
Mais que pensent les étudiants de cette modalité pédagogique inhabituelle ?
« C’était très enrichissant cela nous a permis de revoir des notions de nos cours, c’est une manière ludique de pouvoir voir tout ce que l’on a fait au cours de ces 3 années d’études.
D’autant qu’à la fin de notre 3ème année nous avons un oral sur ces trois années d’études, du coup cela nous permet de revoir des choses qu’on a un peu perdues ».
« Moi je pense que cela nous permet de nous situer sur ce que l’on a assimilé et ce que l’on ne connait pas, et donc, de nous aider dans nos révisions, c’est une révision globale de tout ce qu’on a vu ».
Il est primordial d’avoir à l’esprit que le jeu est utilisé comme un outil pédagogique et non comme une finalité. Faire réviser les étudiants sans qu’ils aient vraiment l’impression de travailler à la mobilisation de leurs connaissances, leur consolidation, ou bien l’intégration de nouvelles et susciter leur motivation, sont les finalités de ce jeu.
La chasse à l’ennui est de rigueur !
 Il est à noter que l’erreur et l’échec sont non seulement permis mais également valorisés par les tuteurs accompagnant les étudiants durant le jeu : ce temps est l’occasion pour les étudiants de se tromper avant un examen final afin de pouvoir se repérer dans l’acquisition des connaissances requises.
Il est à noter que l’erreur et l’échec sont non seulement permis mais également valorisés par les tuteurs accompagnant les étudiants durant le jeu : ce temps est l’occasion pour les étudiants de se tromper avant un examen final afin de pouvoir se repérer dans l’acquisition des connaissances requises.
Selon le Pr Parietti-Winkler, les plus-values pédagogiques de ce jeu sont principalement les suivantes : « La dynamique du jeu et l’envie de gagner incitent les étudiants à interagir entre eux même s’ils ne se connaissent pas. Ça resserre de plus les liens entre les étudiants et les enseignants et leur offre un espace de liberté, une proximité relationnelle avec l’enseignant au-delà de la relation traditionnelle formant/formés… Je me sens proche d’eux d’un point de vue relationnelle. De plus, cela mobilise des connaissances, il y a des petits rappels, ils sont obligés de restituer ce qui est quelque fois difficile pour eux. Je pense qu’il y a un potentiel énorme de ce genre de dispositif ».
Ainsi, le jeu stimule les interactions pédagogiques entre étudiants : afin de faire deviner des mots, ils doivent communiquer, collaborer, ils se félicitent lorsqu’ils réussissent et se soutiennent lorsqu’ils échouent.
Cet acte pédagogique favorise ainsi la zone proximale de développement (Vygostsky, 1985).
Il favorise également la relation enseignant/étudiant.
La posture de l’enseignant semble primordiale dans le jeu. Il ne suffit pas d’être un simple organisateur du jeu,son rôle va plus loin que ça.
En plus d’organiser le jeu, l’enseignant est réellement un tuteur qui fait des rétroactions sur les apprentissages des étudiants afin de réexpliquer les mots à deviner, n’en déplaise aux étudiants : « Ce que j’aime bien c’est que l’enseignante nous a fait un peu des rappels de cours. Moi, personnellement j’ai essayé de prendre quelques notes pour me remettre un peu dans le bain parce que pendant nos stages on n’a pas réellement le temps de revoir nos cours alors qu’on sait qu’à la fin de l’année les examens nous attendent sur ces notions-là ».
L’enseignante insiste : « Le rôle du tuteur est primordial et il est à bien réfléchir ; ce jeu est un prétexte pour faire une séance de révision, ce que le tuteur ne doit pas perdre de vue durant toute la partie ». La médiation de l’enseignant reste donc indispensable.
Toutefois, il est à noter que la construction de ce jeu a demandé un fort investissement de la part de l’enseignante : « L’investissement a été énorme car c’est quelque chose que je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois… J’ai dû le transposer et l’adapter à mes enseignements, j’ai dû faire l’interface sur deux enseignements différents afin de trouver des points communs entre l’orthophonie et l’audioprothèse. Je souhaitais vraiment que cela mette en contact un très grand nombre d’étudiants, le « game design » m’a donc demandé énormément de temps à réfléchir et concevoir ».
Ainsi, les avantages du jeu sérieux reposent sur la motivation des étudiants et le plaisir d’apprendre, l’apprentissage par essai-erreur et un niveau d’interaction élevé.
Les retours informels des étudiants sont très positifs. Toutefois, l’enseignante souhaite évaluer ce dispositif de manière institutionnelle auprès d’eux.
Cette modalité pédagogique peut être tout à fait adaptée à d’autres formations.
Affaire à suivre…

Téléchargez l’article en PDF











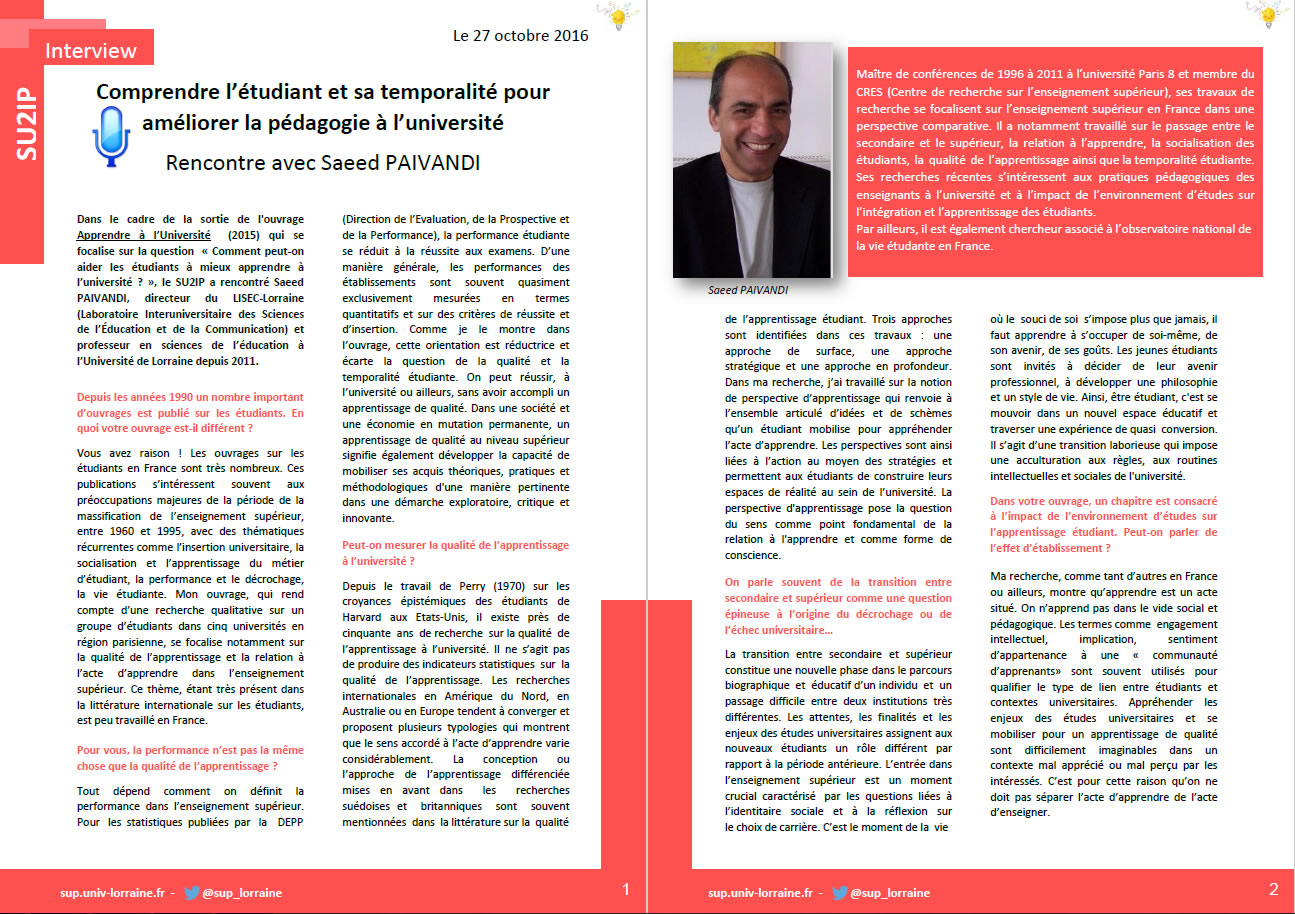

 Le DU Propriété Intellectuelle (PI) est un des rares diplômes modularisé à l’UL. Nous avons voulu en savoir plus sur les motivations des responsables pédagogiques à l’origine de ce projet, sur la méthode utilisée pour le conduire, sur les éventuelles difficultés rencontrées et l’accompagnement qui aurait pu être utile.
Le DU Propriété Intellectuelle (PI) est un des rares diplômes modularisé à l’UL. Nous avons voulu en savoir plus sur les motivations des responsables pédagogiques à l’origine de ce projet, sur la méthode utilisée pour le conduire, sur les éventuelles difficultés rencontrées et l’accompagnement qui aurait pu être utile.