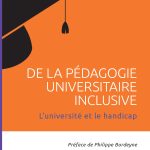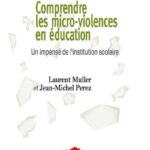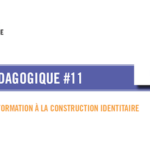Cet ouvrage rassemble les contributions de vingt-cinq auteur·rices autour de la thématique de l’inclusivité appliquée à la pédagogie universitaire. Leurs propos se déclinent en apports théoriques, études de cas, témoignages, retours d’expériences et présentations d’ateliers pratiques.
Il s’agit d’aborder cette lecture comme un outil réflexif questionnant son propre rapport à l’enseignement. À partir de pistes concrètes, cette publication invite chacun·e à déployer et enrichir ses pratiques. Sa force réside dans l’articulation entre approche conceptuelle et retours d’expériences, tout comme dans la diversité des contributions,
dessinant ainsi une réalité de terrain à la fois contrastée et complexe.
Accompagnement et tutorat
L’écho pédagogique #14 – Les pratiques pédagogiques universitaires inclusives
La massification de l’enseignement supérieur, l’hétérogénéité croissante de la population étudiante et la perspective des pouvoirs publics de passer d’une logique d’intégration scolaire à une éducation inclusive sont des facteurs de l’augmentation du nombre d’étudiants en situation de handicap. À la rentrée 2021, plus de 51 000 étudiants se sont déclarés en situation de handicap en France (MESRI, 2022). Si la logique de l’intégration pousse l’étudiant à s’adapter à l’institution universitaire, la logique inclusive, quant à elle, amène l’ensemble des acteurs à s’accommoder aux besoins de chaque étudiant en privilégiant l’accessibilité du système et de l’apprentissage. Ainsi, ce changement de paradigme encourage l’environnement universitaire à se questionner sur les meilleures pratiques pédagogiques à implémenter au sein de l’enseignement supérieur.
L’approche pédagogique inclusive et la conception universelle de l’apprentissage (CUA) apparaissent comme des réponses à la diversité des profils des étudiants en visant l’inclusion et la réussite du plus grand nombre. D’après Beaudoin (2013), la pédagogie inclusive est une approche qui regroupe « un ensemble de pratiques pédagogiques exemplaires » dont la mise en oeuvre prend en compte l’adaptation de la diversité des apprenants (Prud’homme et Bergeron, 2018) sans impacter le niveau d’exigences académiques et avec pour perspective de prévenir les obstacles à la réussite.
Cet écho pédagogique vise à éclairer la thématique de la pédagogie inclusive en donnant une synthèse des travaux des recherches traitant de cette thématique. Ainsi, sont présentés des ressources variées apportant des retours d’expériences, des constats sur l’état actuel, des outils et pratiques afin d’inclure toutes les diversités de profils peuplant les universités.
L’Écho pédagogique #11 – Le stage : de la formation à la construction identitaire
« L’enseignement supérieur a pour mission de préparer les jeunes et les adultes à faire face aux exigences du métier mais aussi à penser, anticiper et réguler les évolutions sociétales. » Xavier Roegiers 1 (2020).
Dans cette perspective, le stage composante majeure dans un programme d’études est une expérience d’apprentissage supervisée qui permet à l’étudiant de mobiliser ses ressources, d’acquérir de nouvelles connaissances, de mettre en oeuvre ses compétences et de développer une réflexion en situation réelle.
Moment significatif du processus de formation, le stage revêt ainsi trois fonctions principales :
- il ancre les apprentissages ; ce dispositif pédagogique s’inscrit dans la lignée de la théorie de l’apprentissage expérientiel, fondée par le philosophe américain John Dewey. Il est le processus permettant la « création de connaissances par la transformation de l’expérience ».
Ainsi, le stage permet d’apprendre en expérimentant mais aussi en ayant un recul réflexif sur ce que l’on observe, sur ce que l’on fait et sur le sens de ce que l’on fait. - il facilite la professionnalisation ; l’étudiant consolide ou infirme son projet professionnel tout en développant des compétences. Il construit également un réseau et acquiert une première expérience du monde professionnel.
- il participe à la construction identitaire de l’étudiant ; selon Denjean2 (2002), « l’intégration des valeurs, de la culture, la confrontation aux stratégies des différents acteurs professionnels amènent l’apprenant à construire son identité professionnelle et sa propre représentation de son environnement professionnel », suivant un processus continu, dynamique et interactif.
Le stage est donc riche de potentialités à la fois formatrices, professionnalisantes et socialisatrices.
Toutefois, la question de l’accompagnement, reste un facteur prépondérant pour la réussite du stage. Glaymann3 (2014) insiste sur le fait que « la richesse pédagogique du stage suppose que le stagiaire soit encadré par un enseignant de son établissement et par un tuteur sur le terrain du stage pour accompagner la mise en oeuvre des savoirs tout en respectant les modes d’action propres à la fonction de travail et à l’organisation ». Si celui-ci est offert selon l’approche réflexive et émancipatrice qu’il incarne, le stage permet l’accès aux pratiques réelles, indispensable au nécessaire soutien à la transformation de l’expérience.
Télécharger l’Écho Pédagogique #11.
1 Xavier ROEGIERS, L’évaluation des étudiants dans une logique de compétences : enjeux et démarches, Rendez-vous de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation, septembre 2020
2 Michel DENJEAN, « Compagnonnage et compétences : Pourquoi ? Comment ? » – Fiche technique n°22 – CEDIP, juin 2002.
3 Dominique GLAYMANN, « Le stage dans l’enseignement supérieur, un dispositif riche de promesses difficiles à tenir », Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, 2014