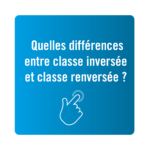- Cours : Français Langue Étrangère
- Public : élèves-ingénieurs étrangers non francophones régulièrement inscrits à l’École Nationale d’Ingénieurs de Metz (Université de Lorraine)
- Niveau de langue : Intermédiaire (B2)
- Titre de l’activité : « Participer dans une réunion de négociation »
- Durée de l’activité : 8 h
- Méthode active d’enseignement : apprentissage par problème (APP)
- Objectifs pédagogiques : développer des compétences langagières de compréhension et d’expression écrites et orales
- Tâches à effectuer par les étudiants, les étapes :
- lecture de la situation-problème ;
- formation des groupes et la répartition des fonctions ;
- rédaction de la lettre ayant provoqué la polémique ;
- clarification de la situation-problème ;
- formulation des hypothèses de travail et la détermination des objectifs d’apprentissage ;
- planification des tâches et la recherche individuelle des réponses ;
- synthèse et la proposition de solutions ;
- simulation de négociation ;
- bilan des acquis.
- Modalités de contrôle des connaissances/compétences : autoévaluation + interévaluation + évaluation formative + évaluation sommative finale
Situation-problème :
GLOBALTECH, une entreprise du secteur des nouvelles technologies industrielles leader en Europe et dont l’activité ne cesse de se développer à l’international, vient d’acheter FRANCOTECH, une société française du même secteur. Tous les employés de cette dernière ont reçu une lettre, de la part de la direction des Ressources Humaines, qui a provoqué une grande polémique. Afin de diminuer les coûts de fonctionnement, tous les employés provenant de fusions récentes devront utiliser l’anglais comme langue de travail. Ce document explique que l’objectif est de former tous les collaborateurs Français afin de les intégrer le plus efficacement possible aux modalités de travail du nouveau propriétaire. Pour y parvenir, des stages linguistiques à destination des employés concernés seront organisés par le Département de Formation de la nouvelle entité dans son siège londonien. Tous les frais occasionnés par cette opération seront à la charge de GLOBALTECH.
L’ensemble des employés Français devra donc atteindre un niveau opérationnel en anglais. Ceux qui possèdent déjà des compétences avérées en cette langue feront seulement un stage de formation technique et administrative d’une durée d’une semaine. Par contre, les employés qui ne manipulent pas encore cet outil linguistique seront obligés de s’inscrire à un stage intensif de deux mois à l’issu duquel un niveau opérationnel sera certifié pour, ensuite, pouvoir suivre le stage de formation technique et administrative. Les employés qui refusent d’y participer seront considérés comme démissionnaires et leur contrat de travail sera résilié.
L’orientation donnée par GLOBALTECH a provoqué l’émergence de trois groupes bien identifiés dans l’entreprise française : les nouveaux dirigeants (qui, pour des raisons de positionnement, soutiennent les mesures prises par le siège), les cadres intermédiaires (qui seraient d’accord avec les nouvelles mesures mais sous certaines conditions) et les représentants syndicaux (qui sont opposés aux décisions prises en haut lieu qu’ils trouvent injustes et inadaptées). Ils devront tous participer à une réunion de négociation afin de trouver un compromis qui ne lèse les intérêts de personne.